La liberté dans la foi
par Joseph Moingt
Il m’a été demandé de vous entretenir de la liberté dans la foi, c’est-à-dire de l’indépendance de parole et d’action dont le fidèle peut jouir ou qu’il est en droit de revendiquer au sein de l’institution religieuse à laquelle il adhère, et en particulier de l’indépendance que peut revendiquer le théologien vis-à-vis de l’autorité religieuse, laquelle prend la forme d’un magistère doctrinal dans l’Église catholique. Je traiterai plus longuement du premier cas, le plus général, et du second seulement par mode de conclusion, dans la mesure où le travail du théologien est sollicité pour résoudre le problème du rapport de la foi à l’autorité. Mais je voudrais prendre en considération, pour entrer dans ce débat, la liberté de la foi, celle que donne la foi, avant de traiter de la liberté dans la foi, de la place que l’institution religieuse laisse à la liberté du croyant. Est-on fondé, en effet, à poser en principe que la foi serait restrictive de liberté, pour qu’on se croie obligé ensuite de plaider en faveur d’un minimum de liberté dans l’Église ? La discussion de ce préjugé fournira un argument de base pour réfléchir ensuite à la liberté du croyant dans la foi.
La liberté de la foi
Le préjugé que la foi serait contraire à la liberté vient soit de la pensée rationaliste soit de la pensée religieuse, soit que la première postule qu’il n’y a de vraie liberté que dans l’usage de la raison, ce qu’on peut concéder, et que la foi se situe en dehors de la raison, dans l’irrationnel, ce qui est contestable, soit que la pensée religieuse se conçoive elle-même comme obéissance à Dieu, ce qu’on doit concéder, et qu’elle se situe en conséquence en dehors du champ de la raison, ce qu’on doit contester. Il ne peut être question d’aborder ici le problème immense des rapports de la foi et de la raison, souvent étudié tant par les philosophes que par les théologiens. J’essaierai seulement de dire comment la liberté élit domicile dans un assentiment de foi raisonné. Il est juste de placer l’usage de la liberté dans le champ du raisonnable, à condition de ne pas confondre rationalité et rationalisme. Il est également juste de comprendre la foi comme obéissance à Dieu, mais librement consentie. Ma réflexion sur la liberté de la foi se bornera à établir ces deux points.
L’idée que la foi prend naissance dans l’irrationnel se nourrit de suppositions incontrôlées sur l’origine des croyances religieuses, qui auraient été provoquées dans la nuit des temps par les frayeurs des hommes primitifs devant des phénomènes naturels qu’ils ne pouvaient expliquer. Les hymnes recueillies dès les débuts de l’histoire mésopotamienne démentent ces suppositions ; ce sont des chants de louange, d’exultation, d’action de grâce qui montrent, au contraire, que l’esprit de l’homme s’est élevé, au sens d’éduqué, en s’élevant vers la pensée des dieux, qu’il y a trouvé le sens de sa dignité, de sa supériorité sur les autres êtres de l’univers, le sentiment de sa libération des forces matérielles de l’univers, et qu’il a aussi crû en liberté en passant de l’idolâtrie au culte d’un dieu souverain, puis au pressentiment d’un dieu unique, qui l’affranchissait de la servitude à de multiples dieux rivaux les uns des autres. Plus tard, la notion biblique de création, qui séparait radicalement la divinité de la matière, ennoblissait l’homme d’autant plus qu’il était créé “à la ressemblance de Dieu” et que la gestion de l’univers lui était confiée. Les historiens modernes savent montrer dans les représentations cosmologiques de la Bible les premiers essais d’explication préscientifique de l’univers, de même que les récits historiques qu’on y trouve sont des essais d’appropriation de leur histoire par les croyants du peuple hébreu. Les Prophètes témoignent de la liberté que leur inspirait la foi pour libérer le peuple de la tyrannie de ses souverains autant que de sa crédulité envers les faux dieux. Les Sages, plus tard, ouvriront la porte à la pensée grecque et n’hésiteront pas à poser à Dieu les interrogations de la raison sur l’origine des choses et le problème du mal et de la mort. On se rappellera enfin et surtout la liberté souveraine que Jésus puisa dans son rapport personnel à Dieu et dont il fit preuve vis-à-vis des traditions et des autorités religieuses du judaïsme de son temps, une liberté qui le conduisit à mourir hors religion, et qui engendra le christianisme à une rationalité et une liberté nouvelles, d’une part en lui inspirant une intelligence réinterprétative des anciennes Écritures, d’autre part en lui donnant l’audace de s’affranchir de la Loi que Moïse avait reçue de Dieu ; et l’Église a reconnu que sa foi est constituée originellement de rationalité et de liberté en se proclamant née de l’Esprit du Christ.
Il reste que cette foi se définit comme obéissance à Dieu ; ce point n’est pas discutable, mais c’est là précisément qu’elle se montre réfléchie et volontaire, et non aveuglément soumise. Tout d’abord, avant d’être acquiescement à un ordre tombé du ciel, la foi est ouverture à l’altérité, écoute attentive, assentiment délibéré, acte de confiance, et elle est tout cela, qu’il s’agisse de la foi que le croyant met en Dieu ou de la confiance que tout individu met en d’autres et sans laquelle il n’y aurait pas d’existence proprement humaine. Car il y a un croire en l’homme qui précède le croire en Dieu, et il est vraisemblable que le second a son origine dans le premier et que le croire en l’homme, inversement, a son fondement et sa fin dans le croire en Dieu. Tout acte de parole, en effet, est appel à un autre, acte de confiance en lui, en sa parole, et la vie entre les hommes serait impossible ou serait inhumaine s’ils ne pouvaient pas se faire confiance les uns aux autres, s’ils ne devaient pas se fier à la parole donnée et reçue. Mais aucun d’eux n’est digne que je lui confie absolument mon existence. La confiance en autrui m’ouvre à une altérité infinie et me prédispose à me confier à un Dieu sauveur. Ma foi en Dieu est éclairée par le témoignage de tous ceux qui ont cru en lui, par la révélation, par la foi de Jésus en celui qu’il appelait son Père, par la tradition de l’Église ; c’est ainsi que j’offre à Dieu, par ma foi, l’assentiment réfléchi et délibéré de mon intelligence et de ma volonté.
On peut apporter des exemples historiques de la liberté de la foi : les chrétiens des premiers siècles en ont témoigné dans les persécutions, ils ont fait preuve de leur indépendance vis-à-vis des pouvoirs politiques et des coutumes de la cité antique, ils ont inauguré un type de socialité décloisonnée et ouverte ; ils ont aussi éprouvé la tentation de rejeter le Dieu créateur puisqu’ils étaient affranchis de sa Loi, mais, en examinant les évangiles, ils se sont convaincus que Jésus ne faisait référence à aucun autre dieu que celui de la Bible, et ils ont fait le choix du Dieu de Jésus comme seul véritable Dieu. Sur un plan plus individuel, toute conversion à la foi est choix d’existence, recherche de sens, engagement de vie, et donc acte de raison et de liberté, et la foi ne se maintient vivante que par la répétition de tels actes. Dans les changements culturels et historiques que traverse toute vie humaine, le croyant est souvent provoqué à remettre en cause ses choix existentiels et ainsi à réexaminer le sens que la foi donne à sa vie et à renouveler ses engagements de foi. Cela lui permet d’expérimenter la hauteur de vue et la liberté que la foi lui procure pour l’arracher aux sollicitations immédiates du plaisir, de la gloriole ou de l’intérêt et pour orienter sa vie vers un surplus d’humanité.
Ces considérations, toutefois, restent abstraites aussi longtemps que la foi est envisagée sous le seul rapport d’un sujet croyant à Dieu, car ce sujet n’est pas isolé, il appartient à un groupe religieux, qui est une institution du croire, et sa foi est déterminée par les traditions et les autorités doctrinales de son Église. C’est le point que nous allons maintenant examiner. Mais nous retiendrons de ces premières réflexions que le croyant garde toujours une ressource de liberté en ramenant toutes les déterminations que lui impose l’institution religieuse à son rapport personnel et fondamental à Dieu. Comment exercera-t-il cette liberté, alors qu’elle paraît conditionnée par son appartenance religieuse ? On va s’efforcer de répondre à cette question.
La liberté du croyant
Il est très vrai que la plupart des personnes sont entrées dans l’Église du fait de leur naissance, de leurs parents, de leur éducation, et non d’un engagement personnel. Il n’en va pas autrement de tout accès initial à une culture, de quelque nature qu’elle soit, cela découle de la socialité de l’être humain. Mais l’individu est amené assez tôt à réviser les orientations de pensée et de vie que d’autres ont prises pour lui et à les assumer ou à s’en dégager après délibération. Est-il particulièrement difficile de se libérer d’une tradition religieuse ? Si ce fut le cas dans le passé, ce ne l’est plus aujourd’hui, dans nos pays, où les rouages de la transmission ne fonctionnent plus sur aucun plan, ni familial ni social ni culturel ni politique. Quand l’indifférence et l’incroyance se répandent dans tous les milieux et se contractent dès l’adolescence, la libération d’une tradition religieuse se fait généralement sans effort, rien qu’en suivant les manières de penser et de vivre les plus courantes, alors que la croyance inculquée dans la petite enfance ne se maintient pas sans des efforts toujours renouvelés de réflexion et de volonté. Si l’on admet que le sujet, l’individu vraiment libre, est celui qui a l’intelligence et le courage de “faire exception”, c’est-à-dire de “ne pas se conformer au siècle”, aux modes et aux opinions communes, ainsi que le dit un philosophe contemporain en citant saint Paul, force est de reconnaître que la liberté, de nos jours et dans nos pays, se trouve du côté de la foi plutôt que de l’incroyance.
Mais cette observation ne touche pas encore au fond du problème : quelle liberté l’institution religieuse laisse-t-elle au croyant qui s’est résolu à penser et à vivre en croyant ? S’il est totalement libre à l’égard des sollicitations du monde, l’est-il au même degré à l’intérieur de son Église ? Nous poserons en principe qu’un catholique convaincu est disposé à croire et à pratiquer tout ce que croit et pratique l’Église, c’est-à-dire tout ce qu’elle tient pour vérité authentiquement révélée et pour moyen nécessaire de salut, et qu’il y adhère en connaissance de cause et librement, aussi longtemps du moins qu’aucun doute ne s’est élevé dans son esprit au sujet de cet enseignement. Toutefois, quand il se tient en rapport de soumission vis-à-vis de l’Église, il la pose comme une institution hiérarchique qui lui est extérieure et qui a reçu de Dieu autorité pour dire la foi, et il convient d’étudier concrètement la liberté du croyant du point de vue de ce rapport.
Le magistère de l’Église ramène volontiers l’obéissance de la foi à la soumission envers lui, en vertu du principe que le Christ a donné aux successeurs des apôtres toute autorité pour enseigner son Évangile et pour guider ceux qui voudront être ses disciples dans les voies du salut. Nous ne contesterons pas le principe, sauf à examiner son application. Elle est limitée par hypothèse à ce que l’Évangile enseigne et ordonne dans l’ordre du salut, et c’est strictement dans cette limite que la soumission à l’autorité de l’Église est la libre obéissance de la foi due et rendue à Dieu même et à lui seul. Le magistère de l’Église admet cette limite en théorie, mais la respecte très mal en pratique, car il considère que lui seul a autorité pour dire la foi telle qu’il l’entend ; il n’accepte pas que d’autres, de simples fidèles, s’en mêlent et moins encore qu’ils mettent en cause la légitimité de son enseignement, sa provenance authentique de la révélation. Avant tout examen du contenu de cet enseignement, le mode d’exercice solitaire et autocratique de l’autorité religieuse est sujet à critique du point de vue de la liberté du sujet croyant.
Cette liberté est à double entrée : elle vient de l’Esprit Saint et également de la nature humaine.
D’une part, Jésus a promis de donner “l’Esprit de vérité” à ses disciples, à tous, présents et futurs, pour les “guider vers la vérité tout entière”. Que quelques-uns seulement aient autorité pour énoncer la vérité dans l’ordre de la succession apostolique, cela ne veut pas dire que les autres seraient inaptes à la pressentir et à la comprendre et qu’il n’y aurait ni légitimité ni utilité à les consulter. On constate dans les premières communautés chrétiennes une grande et libre circulation de la parole, qui n’était pas réservée à ceux qui les présidaient et gouvernaient, lesquels n’étaient d’ailleurs pas encore consacrés à cet effet. Plus tard, lors des premiers conciles, auxquels participaient quelques simples prêtres, diacres ou laïcs, les évêques étaient convoqués avant tout pour témoigner de la foi de leurs Églises, de leurs fidèles. Plus près de nous, quelques définitions pontificales ont été précédées de consultations auprès des évêques, qui faisaient état du sentiment des fidèles voire de pétitions sur le point à définir. Il ne devrait donc pas y avoir d’obstacles de principe à inviter les fidèles à débattre de questions qui intéressent grandement leur intelligence et leur vie de foi.
D’autre part, l’homme répugne naturellement à ce qu’on lui impose des choses à croire et à pratiquer au seul nom de l’autorité, sans qu’il soit admis à en vérifier au préalable le bien-fondé, dans la mesure où il en est capable et où ces choses ont de l’importance à ses yeux. Pendant longtemps, les fidèles ont accepté de telles décisions sans difficulté, parce qu’ils avaient l’habitude d’être commandés de la sorte, parce qu’ils étaient illettrés ou peu instruits ou qu’ils ne disposaient pas de l’Écriture Sainte ou parce qu’ils révéraient toute autorité sacrée et tout ce qui leur était présenté sous le couvert du mystère. Il n’en va plus de même de notre temps. L’Église a perdu et continue à perdre de nombreux fidèles parce qu’elle ne se résignait pas et ne se résout toujours pas à les traiter en personnes majeures, capables et désireuses de répondre par elles-mêmes de leur foi, de leur intelligence de la foi, de leur vie de foi et de leur vivre en Église. Des fidèles qui ne jouissent pas dans l’Église du même respect de leur liberté ni du même sentiment de responsabilité que dans la société civile et politique en viennent vite à se désintéresser des choses de la foi et à cesser de fréquenter habituellement l’Église.
Du seul point de vue formel du rapport à l’autorité, on peut donc conclure qu’une soumission absolue au magistère de l’Église ne conduit pas infailliblement à la vraie obéissance de la foi, loin de là, et qu’il serait mieux avisé de tenir davantage compte du changement des mentalités et surtout de faire davantage confiance à l’Esprit qui inspire les fidèles, pour les questionner, les écouter, les laisser prendre des initiatives, comme le souhaitait Vatican II, et les inviter à prendre leur part de responsabilité dans le discours et la vie de l’Église. La foi serait finalement gagnante à une plus grande liberté des croyants.
Pour creuser plus à fond le problème de la liberté dans la foi, il faudrait passer du point de vue formel dont je viens de parler à la détermination des plans sur lesquels elle aurait à s’exercer. J’évoquerai rapidement le plan de la doctrine et celui de l’éthique, puis celui du gouvernement de l’Église et de sa mission.
Sur le plan de la doctrine, il ne faut évidemment pas donner prétexte à la caricature qui soumettrait l’interprétation des évangiles et les définitions de la foi au vote majoritaire des croyants. Pour déterminer les points de doctrine qui appartiennent authentiquement à la foi de l’Église, il est indispensable de savoir lire et interpréter les Écritures, de connaître l’histoire et la tradition de l’Église et d’être aussi capable d’une réflexion philosophique. J’en parlerai dans un instant à propos de la liberté du théologien, non que les questions doctrinales lui soient réservées, mais parce qu’il y faut des connaissances techniques, comme pour tant d’autres questions qui relèvent de la science.
Les fidèles, d’ailleurs, s’intéressent d’ordinaire davantage aux questions éthiques, qui concernent leur vie de chaque jour et qui alimentent les problèmes de société dont les média discutent passionnément : sexualité, contraception, famille, vie de couple, éducation des enfants, éthique médicale, droit à la vie et droit à la mort, droits de l’homme, de la femme et de l’enfant, justice sociale, économie durable, écologie, etc. Sur toutes ces questions et sur bien d’autres du même ordre éthique, l’Église ne cesse de légiférer avec autorité, souvent au nom de ce qu’elle appelle la loi naturelle, alors que ces questions relèvent de la raison, du bien social commun, donc du débat public, et l’Église en parle sans questionner et sans laisser intervenir ses fidèles laïcs, qui en ont pourtant une expérience personnelle, parfois une connaissance technique, et qui en prennent conscience avec l’assistance de l’Esprit Saint. Voilà donc un immense domaine, d’extrême importance et urgence, sur lequel les croyants doivent prendre position, revendiquer leur liberté de parole et dire une parole de foi dans l’Église et en son nom dans le monde. Mais comment faire en sorte que se forme et s’exprime d’abord, dans la foi, le jugement des fidèles sur ces questions, puis qu’il remonte aux instances délibératives qui lui donneraient la forme et la force d’une conviction commune, et que celle-ci débouche enfin dans le débat public où s’élaborent les décisions et les lois de la société civile et politique ? La question ramène au rapport des fidèles à la hiérarchie, envisagé maintenant sous la forme concrète du gouvernement de l’Église.
Du point de vue de la liberté dans la foi, le seul qui nous intéresse ici, le problème du gouvernement de l’Église consiste à examiner la place qui devrait être faite aux “simples” fidèles dans ses instances délibératives et exécutives pour qu’ils soient reconnus en tant que personnes majeures dans la foi, qui jouissent collectivement de l’assistance du Saint Esprit, afin que leur dignité soit signifiée dans l’Église comme elle l’est dans la société civile et politique et que leur foi soit d’autant plus affermie que serait honorée leur responsabilité de l’être-ensemble de l’Église. Ce problème doit aussi être examiné sur le plan de la collégialité et de la subsidiarité. Actuellement l’épiscopat fonctionne pratiquement en tant que représentant de l’autorité romaine dans les Églises locales ; il faudrait qu’il soit également le représentant légitime de ces Églises auprès de l’autorité centrale, ce qui obligerait à organiser la représentativité de l’Église locale en tant que telle. Mais Rome a manifesté les plus vives craintes dans les siècles récents d’introduire dans l’Église des facteurs de démocratie et de décentralisation. C’est dire qu’il y aura un long chemin à parcourir avant que la liberté de la foi devienne un fait accompli dans l’Église, et que l’énergie des croyants devra longtemps se mobiliser dans ce but.
Il faudrait enfin considérer le rapport de la liberté des croyants à la mission de l’Église dans le monde. Car la question ne peut pas se réduire à celle d’une meilleure organisation de l’espace ecclésial, mais doit s’étendre au service du monde auquel l’Église est envoyée. Elle sera de plus en plus sollicitée d’aider à la solution, théorique et pratique, des graves problèmes politiques, économiques et sociaux qui engagent l’avenir de la planète. Il incombera spécialement aux fidèles laïcs, en tant qu’ils sont citoyens à la fois de l’Église et du monde, de prendre part à ces débats et à ces actions, pour y faire entendre la voix de l’Église et y engager sa responsabilité. Ce qui met à nouveau en cause la question de la représentativité des fidèles dans le discours et la vie de l’Église. Elle ne sera pas résolue sans faire appel à la théologie. C’est pourquoi je conclurai ces réflexions par une brève interrogation de la liberté du théologien.
La liberté du théologien
Dans le cas du théologien comme dans celui de tout croyant, le problème de la liberté dans la foi se pose en termes de représentativité ou encore de positionnement. Le théologien jouissait au Moyen Âge d’une assez grande autorité et indépendance due à sa position d’universitaire. Il a perdu l’une et l’autre depuis la Contre-Réforme, où il s’est vu généralement affecté à la formation des clercs dans les séminaires ou, plus tard, dans des Facultés placées sous le contrôle de l’autorité épiscopale ou romaine, et de plus en plus de Rome directement. Il est alors censé répercuter purement et simplement l’enseignement du Magistère dûment codifié par des congrégations ou commissions romaines, il représente l’autorité de l’Église enseignante devant les fidèles qui lui doivent obéissance. Les théologiens se sont sentis davantage surveillés depuis les condamnations des “idées nouvelles”, libéralisme, rationalisme ou modernisme, vers lesquelles inclinaient certains d’entre eux. L’exégèse a joui d’une plus grande liberté depuis le milieu du siècle dernier, pour autant qu’elle s’en tient à l’explication des textes sacrés selon des procédures scientifiques appropriées et inattaquables en tant que telles. Mais la théologie, tout en bénéficiant de ces explications, n’a pas le droit de s’écarter d’une interprétation des Écritures conforme à l’enseignement de l’Église et à la Tradition ni de la doctrine officielle telle qu’elle est exprimée dans les définitions conciliaires et les documents pontificaux. La liberté de la recherche théologique n’en est pas moins proclamée, pourvu qu’elle se tienne dans le cadre de la vérité enseignée par le Magistère. En d’autres termes, le théologien ne jouit en théorie d’aucune liberté, car une recherche encadrée par l’autorité ne peut pas bénéficier des critères de la rationalité scientifique de notre temps. Il n’a en pratique que la liberté qu’il osera s’attribuer, à ses risques et périls.
Le théologien, que nous supposons fidèle à la foi de l’Église, dispose cependant de la possibilité de l’interpréter différemment de son enseignement officiel par la vérification de ses sources, scripturaires et traditionnelles, et par le contrôle de ses représentations et expressions, historiques et philosophiques. Il met ainsi à l’oeuvre une réflexion critique intérieure à la foi, il use d’une liberté qui lui vient de la foi elle-même. Ainsi, pour m’en tenir à un seul exemple, que je ne détaillerai pas, la christologie contemporaine a pu prendre le risque d’une révision des concepts chalcédoniens en se tenant plus près des récits évangéliques, normatifs de notre intelligence de la personne du Christ, d’un côté, et plus près, d’autre part, des requêtes de l’anthropologie moderne, normative de notre compréhension de son humanité. La fidélité à la foi, dont peut alors se targuer le théologien, ne le met pas sûrement à l’abri des censures de l’autorité, mais il peut s’aventurer en toute sécurité de foi dans cette recherche, justement parce qu’elle lui est inspirée par une meilleure intelligence de la vérité de la foi elle-même. La liberté qu’il tire de son ancrage dans la foi “assure” celle qu’il prend vis-à-vis de l’institution du croire qui le contrôle.
D’autres motivations le guideront et l’affermiront dans sa prise de liberté. D’abord, de nombreux théologiens d’aujourd’hui ne se positionnent plus en porte-parole de l’Église enseignante face au peuple chrétien, mais se préoccupent davantage d’interpréter les requêtes des fidèles en matière d’intelligence de la foi, de discuter avec eux des questions qu’ils soulèvent, et de porter à la connaissance du Magistère leurs aspirations et leurs protestations, leurs désirs et leurs refus. Ainsi aideront-ils les fidèles à accéder au discours de la foi et à prendre la parole et leur juste place dans l’Église. En second lieu, nombreux sont les théologiens à s’inquièter du discrédit dans lequel tombe si souvent le discours officiel de l’Église, des critiques suscitées par maintes attitudes de sa hiérarchie, de la mécompréhension fréquente de ses dogmes, de l’indifférence croissante à l’égard des vérités de la foi, et ils ressentent la nécessité d’innover le langage de la foi, de le rendre pensable aux nouvelles mentalités, de l’ouvrir aux questions qui préoccupent notre monde sécularisé et laïcisé : autant de motivations de foi qui encourageront les théologiens à prendre plus de risques.
De bons observateurs de la scène publique pensent que la mondialisation entraîne notre temps dans un tournant de civilisation tel que beaucoup de nos anciens discours et comportements ne tarderont pas à être en perte totale de signifiance et d’efficacité. Les discours et comportements religieux résisteront-ils à ce courant ? Serait-ce sur ce point que le sujet croyant devrait “faire exception” et maintenir fermement la tradition chrétienne au lieu de se laisser emporter par le cours du temps ? Assurément, mais pas en se clôturant dans le passé de notre tradition ; bien au contraire, en se confiant à la puissance de novation qui l’a portée jusqu’à nous, en libérant les germes de nouveauté qui constituent la Bonne Nouvelle de Jésus Christ. La nouveauté des temps est l’ultime motivation qui encourage les croyants, fidèles, théologiens et pasteurs, à prendre plus de liberté dans la foi, pour l’avenir de la foi.
J. Moingt
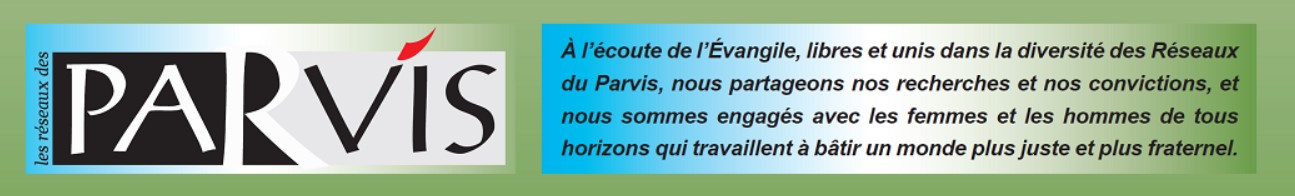
Laisser un commentaire